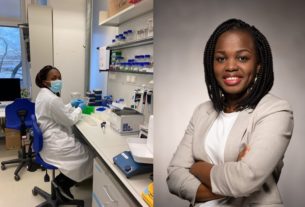Artiste visuel belgo-congolais et enseignant en photographie à l’académie des beaux-arts de Kinshasa, Léonard Pongo est également réalisateur de films. Sa première monographie « The Uncanny » a récemment été publiée par Gostbooks, une maison d’édition indépendante spécialisée dans les arts visuels et la photographie, basée à Londres. The Uncanny est un projet photographique réalisé entre 2011 et 2017 dans les centres urbains du Congo.
Africanshapers: depuis quand évoluez-vous comme artiste visuel ?
Léonard Pongo : je suis enseignant à l’académie des beaux-arts depuis l’ouverture du département photo, il y a trois ans. Mais, je donnais déjà des workshops depuis 2018, en collaboration avec le Goethe Institut de Kinshasa. J’ai également enseigné la photographie en Malaisie, de 2014 à 2018.
Comment êtes-vous passé de la Belgique en Malaisie ?
Très tôt, je n’ai pas voulu limiter mon travail à l’environnement belge. Je trouvais des lieux et des partenaires pour montrer mon travail en dehors de la Belgique. J’ai pris l’habitude de communiquer en anglais, à la suite de mes études en sciences politiques, afin de pouvoir être en contact avec un large public. J’avais envoyé en Malaisie un travail que j’avais commencé à réaliser à Kinshasa en 2011 et que j’ai continué après dans plusieurs villes du Congo. Je l’envoyais à des festivals et à des structures. C’est ainsi que j’ai été sélectionné dans plusieurs festivals et cela m’a permis de me créer un réseau. Lors d’un festival au Cambodge, le directeur d’un autre festival en Malaisie a vu mon travail, a aimé mon approche et m’a proposé d’enseigner. Il collaborait avec l’Australie et donc, des étudiants australiens venaient aussi, en plus des étudiants en provenance de toute la Malaisie. Tous les étés, pendant 5 ans, j’étais donc invité à enseigner en Malaisie. Je faisais principalement de l’accompagnement artistique, en guidant des jeunes photographes à développer leurs projets.
Comment passe-t-on des sciences politique à artiste visuel ?
C’est un travail de « corruption » de longue durée de mon père qui est architecte (Rires). Depuis notre plus jeune âge, il nous a formés à la narration, parce qu’il faisait venir des amis conteurs depuis qu’on était petits. Nous avons grandi avec cette culture d’écouter des histoires nous être racontées et une culture africaine toujours partagée. En outre, toutes les semaines, mon père nous donnait un espace pour dessiner. C’était un cours de dessin très libre, où on n’avait aucune obligation. L’objectif était seulement de dessiner. J’ai effectué des études en sciences politiques. Mais, je me suis rendu compte qu’il me manquait quelque chose : une capacité de s’exprimer visuellement et pas seulement d’écrire des essais scientifiques. C’est à ce moment que je me suis remis à pratiquer les arts visuels par la photographie. J’ai appris, par moi-même, l’utilisation de l’appareil photo. En même temps, je travaillais comme graphiste pour le compte de mon association d’étudiants. C’est ce qui a aussi aiguisé mon œil. En 2009, j’ai suivi des cours de photographie à Bruxelles et, en 2010, j’ai commencé à travailler comme pigiste pour un journal de Bruxelles.

Vous venez de publier votre première monographie « The Uncanny ». Quel est le contenu de cet ouvrage ?
The Uncanny est un terme issu de la psychanalyse freudienne. C’est l’idée de l’étrangement familier. Être dans un endroit familier, que vous reconnaissez, mais que les choses ne soient pas comme on les attend, comme, par exemple, un élément qui ne soit pas à sa place ou n’ait pas la bonne couleur. C’était très connecté avec mon vécu. Être au Congo, un endroit que je connaissais uniquement via les membres de ma famille. Pour beaucoup de jeunes de la diaspora, même si on grandit dans un pays donné, notre référence culturelle et identitaire est le Congo, pays qu’on ne connaît que via les adultes qui sont autour de nous ou les informations que l’on peut consulter depuis l’extérieur. Je souhaitais exprimer ce sentiment d’être dans un environnement connu mais parfois très différent de ce que je m’imaginais. Ce choc a eu un impact sur moi car j’ai été transformé, lorsque je me qui reconnecté avec mes racines. C’était aussi une manière d’emmener les lecteurs dans une expérience de cet espace complexe. Je voulais inclure le public dans quelque chose de très personnel, tout en lançant un message polysémique de la réalité complexe de la RDC.
Quels sont les thématiques abordées dans le livre ?
Plusieurs thématiques sont abordées dans le livre. Outre l’expérience d’un espace complexe, le livre aborde un parcours à travers plein de réalités que l’on peut trouver au Congo et qui constituent le quotidien des Congolais. J’ai réalisé le livre en suivant le quotidien des membres de ma famille et aussi en collaborant avec des équipes de télévision qui rapportent des informations quotidiennes. Il y a ce mélange entre informations qui ne sont pas « intéressantes » pour la scène internationale mais qui, sur le plan national, reflètent la vie journalière des Congolais. Ce sont des réalités avec lesquelles je voulais me connecter. C’était donc important pour moi de mettre en avant ces éléments. En dehors des photos, le livre contient un texte très court, écrit par Nadia Yala Kisukidi, professeure de philosophie à Paris.
Est-ce que les gens ont accepté facilement d’être photographiés ou encore d’être publiés dans un livre ?
Souvent, dans le monde occidental, il existe ce rapport à l’image. On m’a très souvent dit, qu’à Kinshasa, je ne pourrais jamais prendre des photos, que j’aurais des problèmes et des conflits. Cela n’a pas été le cas pour moi. Les gens s’expriment sur le fait qu’ils sont d’accord ou pas de se faire photographier. Il vous questionnent. Ça n’a pas toujours été très confortable pour moi, mais ça m’a aidé à me connecter. Si vous tenez un appareil photo, les gens vous demandent la raison pour laquelle vous prenez des photos. C’est juste une manière de créer le lien et le contact. Et, très souvent, les gens ne souhaitaient pas être photographiés. Ce n’était pas un problème pour moi. Mon but n’était pas prendre des images d’une personne bien définie, mais plutôt de vivre l’ambiance d’un espace et de le communiquer. J’ai pris, par exemple, des images dans un bar qui n’existe plus et qui s’appelait « Les branchés ». Cela m’a pris un mois pour venir voir régulièrement les jeunes qui s’y trouvaient. Quand les images étaient prises, je les leur remettais aussi . Au final, ce sont eux qui me demandaient des les prendre en photo. 12 ans plus tard, c’est un bonheur de pouvoir regarder toutes ces archives photographiques. Le fait qu’une personne refuse d’être photographiée n’est pas une limitation.

Combien de photos contient le livre ?
Le livre contient 111 images. Ce qui est beaucoup pour un ouvrage consacré à la photo. Ces images ont été prises entre 2011 et 2018. J’ai effectué un travail de sélection, car j’ai pris près de 70.000 photos pour ce projet.
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour publier le livre ?
Dans le monde la photo, en général, ce sont les photographes qui payent pour que leur livre soit publié. J’ai refusé cette procédure dès le début, car ça coûte trop cher. J’ai fait des recherches pendant plusieurs années et j’ai pu obtenir une bourse en 2020 qui m’a permis de publier ce livre. Je ne dois pas payer l’éditeur, car c’est la maison d’édition qui couvre les frais. Si les livres sont vendus, je n’ai pas de bénéfice personnel, mais cela me permet d’avoir mon livre sur le marché et de pouvoir diffuser mes photos. Donc, c’est grâce à cette bourse que j’ai pu publier « The Uncanny ». A partir de 2020, il m‘a fallu encore deux ans de travail pour constituer vraiment le livre avec notamment le choix des images finales à publier.
Certaines de vos photos sont actuellement exposées à la Tate Museum de Londres. De quelles œuvres s’agit-il ?
C’est un nouveau projet sur lequel je travaille depuis 2017 et qui s’appelle « Primordial Earth ». La base du projet est un questionnement par rapport à la terre. J’ai grandi avec l’idée que notre identité est issue de la terre de chez nous et qu’on est un peu un morceau de notre territoire. J’ai voulu questionner la manière d’entrer en dialogue avec notre terre. C’est une lettre d’amour adressée à la terre congolaise et à nos traditions. Je voulais vraiment comprendre et aussi m’inscrire dans une ligne de pensée traditionnelle. La question principale était de savoir comment je peux représenter le paysage congolais en suivant les traditions. Pour cela, j’ai questionné des personnes âgées, des chefs traditionnels et aussi ma famille. Je me suis également rendu dans des sites clés au Congo, à la symbolique très forte, notamment à Monkoto,. J’essayais de trouver des endroits qui résonnaient un peu des lieux décrits dans les traditions ou des éléments et des formes qui apparaissent souvent.
Le but de cette exposition est donc d’essayer de recréer un espace où on peut faire l’expérience de la puissance et de la beauté de notre terre.

Quels sont les lieux où vous vous êtes rendus au Congo ?
Je me suis rendu dans des sites clés au Congo, à la symbolique très forte, notamment à Monkoto,, à Kananga, au Katanga et au Kivu. J’ai été dans le village de ma famille « Mukengele » dans le Kasaï, dans le territoire de Dibaya. Je suis allé à Kananga, où j’ai parlé avec le chef Kalamba. Je l’ai interrogé sur les lieux où lui pensait que je devais aller pour représenter notre terre. J’ai également parcouru la rivière Luluwa. Je me suis rendu à Monkoto, dans la province de l’Equateur ; dans le parc de la Garamba ; dans le parc national des Virunga ; au Kongo Central. Je suis également monté jusqu’au sommet du Nyiragongo, où j’ai passé quelques nuits avec une équipe de scientifiques. A la fin de l’année dernière, j’ai passé un mois et demi au parc national de l’Upemba (Katanga).
Tous ces voyages sont auto-financés ?
Jj’ai une carrière de photojournaliste depuis 10 ans et mes commandes me servent à arriver jusqu’à certains endroits. J’ai aussi bénéficié du soutien du parc de l’Upemba et de sa directrice, Tina Lain, ainsi que de plusieurs bourses de soutien à la création et de récompenses pour mon travail, qui m’ont permis de continuer mes projets.
L’exposition « Primordial Earth » est-elle aussi montrée au Congo ?
Oui. Déjà, comme je suis enseignant au Congo, j’organise des sessions avec les étudiants à l’académie des beaux-arts à propos des films sur lesquels j’ai travaillé ou sur mes expositions. L’année passée également, au mois d’août, j’ai présenté mon travail lors des premières rencontres de la photographie à l’académie des beaux-arts. Le projet photo « Primordial Earth » a été montrée pour la première fois à Bamako, en 2019. Le mois suivant, le projet photo a également été montré à la biennale de Lubumbashi. Maintenant, je cherche un lieu pour montrer l’exposition à Kinshasa. Néanmoins, le court-métrage (Primordial Earth: inhabiting the landscape) a déjà été montré à l’édition 2022 de la biennale de Lubumbashi.
A ce sujet, vous êtes en train de réaliser un film, dont la sortie est prévue pour bientôt…
En effet, ce film expérimental sortira l’année prochaine et s’intitule « Tales from the Source » (Les récits de la source). Il dure 39 minutes et je l’ai réalisé pendant 2 ans. Il s’inscrit toujours dans la dynamique de montrer le paysage congolais comme une source de connaissances pour l’humanité.

Il vise aussi à présenter une vision de la terre inspirée des symboliques et des traditions qui découlent de nos identités. Le Congo compte plus de 400 ethnies et c’est une énorme richesse. Il s’agit de questionner si les sources sont dans la terre et si l’on peut dialoguer avec le paysage. Est-ce que le paysage va me répondre ? Est-ce que je peux retrouver les formes symboliques dans nos arts traditionnels qu’on qualifie souvent d’art primaire, comme si c’est un art moins important que l’art que l’on retrouve en occident. Pour moi, l’art traditionnel a une complexité et incarne des philosophies. Ce sont des peuples qui ont vécu pendant des générations et ont construit leurs propres connaissances et celles de leur environnement. Il y a donc une grande richesse. J’emprunte cette idée au philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, qui a écrit un livre à ce sujet, intitulé « L’art africain comme philosophie ». C’est ce qui m’a poussé à me questionner sur le sujet et à le décliner du point de vue de la RDC et par la vidéo. Le film sera diffusé à la biennale de Lubumbashi, l’année prochaine.
Quels sont les autres films que vous avez déjà réalisés ?
The Necessary Evil (Le Mal nécessaire) que j’ai réalisé entre 2011 et 2013 dans les églises de réveil à Kinshasa ; « Primordial Earth », réalisé en 2020, propose une lecture de la vie sur terre avec le Congo comme la source de tout, l’alpha et l’omega de la vie sur la planète. Et puis, « Tales of the source » qui sortira l’année prochaine.
Vos projets ?
Pour l’année prochaine, diffuser le film, en trouvant les plateformes qui pourront le mettre en avant. J’aimerais aussi le présenter au Congo. Deux installations multimédia sont déjà prévues à Marrakech pour le mois de février 2024, pas seulement pour le film, mais pour tout mon travail artistique. Jez compte également participer à la biennale de Dakar, événement clé de l’art contemporain sur le continent qui aura lieu au mois de mai, et aussi à la biennale de Lubumbashi.